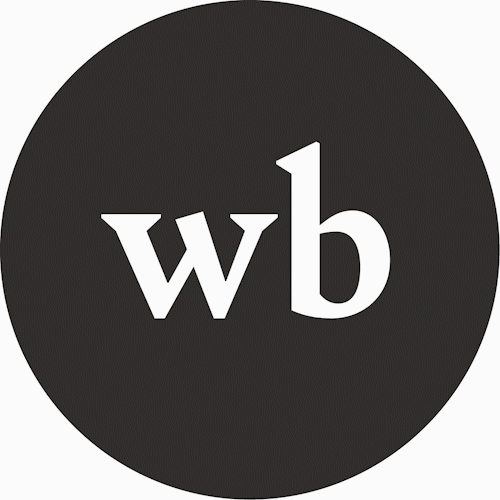“Le roman n’examine pas la réalité mais l’existence. Et l’existence n’est pas ce qui s’est passé, l’existence est le champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut devenir, tout ce dont il est capable.
Les romanciers dessinent la carte de l’existence en découvrant telle ou telle possibilité humaine. Mais encore une fois : exister, cela veut dire “être-dans-le-monde” [in-der-Welt-sein, concept de Heidegger qui schématiquement implique que l’homme et le monde sont liés comme l’escargot et sa coquille, au fur et à mesure que le monde change, l’existence de l’homme change aussi].
Il faut donc comprendre et le personnage et son monde comme possibilité. […]
”
Le romancier n’est ni historien ni prophète : il est explorateur de l’existence.
“Les racines de la crise [dont parle Husserl], il croyait les voir au début des Temps modernes, chez Galilée et chez Descartes, dans le caractère unilatéral des sciences européennes qui avaient réduit le monde à un simple objet d’exploration technique et mathématique, et avaient exclu de leur horizon le monde concret de la vie, die Lebenswelt, comme il disait.
L’essor des sciences propulsa l’homme dans les tunnels des disciplines spécialises. Plus il avançait dans son savoir, plus il perdait des yeux et l’ensemble du monde et soi-même, sombrant ainsi dans ce que Heidegger, disciple de Husserl, appelait, d’une formule belle et presque magique, “l’oubli de l’être”.
[…]
La “passion de connaître” (celle que Husserl considère comme l’essence de la spiritualité européenne) s’est alors emparée de lui [il parle du roman] pour qu’il scrute la vie concrète de l’homme et la protège contre “l’oubli de l’être ; pour qu’il tienne "le monde de la vie” sous un éclairage perpétuel.
”
“Kafka et Hasek nous confrontent donc à cet immense paradoxe : pendant l’époque des Temps modernes, la raison cartésienne corrodait l’une après l’autre toutes les valeurs héritées du Moyen Âge.
Mais, au moment de la victoire totale de la raison, c’est l’irrationnel pur (la force ne voulant que son vouloir) qui s’emparera de la scène du monde parce qu’il n’y aura plus aucun système de valeurs communément admis qui pourra lui faire obstacle.
Ce paradoxe, mis magistralement en lumière dans Les Somnambules de Hermann Broch, est un de ceux que j’aimerais appeler terminaux. Il y en a d’autres. Par exemple : les Temps modernes cultivaient lerêve d’une humanité qui, divisée en différentes civilisations séparées, trouverait un jour l’unité et, avec elle, la pais éternelle. Aujourd’hui, l’histoire de la planète fait, enfin, un tout indivisible, mais c’est la guerre, ambulante et perpétuelle, qui réalise et assure cette unité de l’humanité depuis longtemps rêvée. L’unité de l’humanité signifie : personne ne peut s’échapper nulle part.”